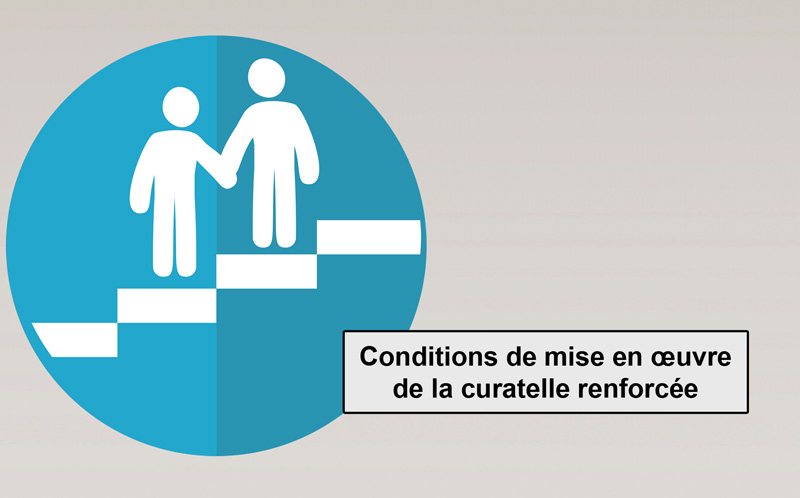Curatelle renforcée : réaffirmation de l’exigence de l’inaptitude à percevoir et utiliser les revenus
La protection des majeurs vulnérables constitue un enjeu fondamental du droit civil français, marqué par une tension permanente entre la nécessité de préserver l’autonomie de la personne et celle d’assurer sa sécurité juridique et patrimoniale.
|
Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien |
Les régimes de protection (tutelle, curatelle simple ou renforcée), encadrés par les articles 425 à 515 du Code civil, répondent à cet équilibre délicat en adaptant la mesure aux facultés de l’intéressé.
L’arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 5 février 2025 illustre cette problématique en se penchant sur les conditions de validité d’une curatelle renforcée, régime particulièrement intrusif qui transfère au curateur la gestion complète des revenus de la personne protégée. (1)
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection de Besançon avait initialement refusé d’instaurer une mesure de protection pour Mme [D], avant que la cour d’appel ne décide, en appel formé par son fils, de la placer sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, en désignant l’UDAF du Jura comme curateur. Ce revirement judiciaire a donné lieu à un pourvoi en cassation, centré sur le respect des exigences légales de l’article 472 du Code civil.
La Cour de cassation, tout en validant partiellement l’arrêt d’appel, en censure la motivation sur un point crucial : l’absence de vérification préalable de l’inaptitude de Mme [D] à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, condition sine qua non pour justifier une curatelle renforcée.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation, soucieuse de garantir le strict respect des conditions légales des régimes de protection, afin d’éviter toute atteinte disproportionnée aux droits des personnes vulnérables. Il rappelle avec force que la curatelle renforcée ne saurait être prononcée par simple référence générique aux articles du Code civil, mais exige une appréciation concrète et individualisée des capacités de l’intéressé. En l’occurrence, la cour d’appel a omis de motiver sa décision sur ce point essentiel, privant ainsi sa décision de base légale au sens de l’article 472, alinéa 1er, du Code civil. (2)
Au-delà de l’aspect technique, cette décision soulève des questions fondamentales sur les garanties procédurales entourant les mesures de protection et sur l’effectivité du contrôle exercé par le juge. Elle met en lumière les risques d’une application mécanique des régimes de protection, au détriment d’une analyse approfondie des besoins réels de la personne. Par ailleurs, la Cour de cassation précise les conséquences de la cassation partielle : seule la modalité de la curatelle renforcée est annulée, sans remettre en cause la durée de la mesure ni la désignation du curateur, dès lors que ces éléments ne sont pas affectés par le vice de motivation.
Enfin, cet arrêt interroge sur la portée de l’obligation de motivation des juges du fond en matière de protection des majeurs, et sur les limites de l’office du juge de cassation lorsque la mesure contestée a déjà produit ses effets. La Cour, en refusant de renvoyer l’affaire devant une nouvelle juridiction d’appel – au motif que la mesure initiale de tutelle a épuisé ses effets –, illustre la complexité des interactions entre les principes de sécurité juridique et de protection effective des droits.
I. La réaffirmation des conditions strictes de la curatelle renforcée : un contrôle rigoureux de la motivation des juges du fond
A. Les exigences légales de l’article 472 du Code civil : l’inaptitude à gérer les revenus comme critère déterminant
La curatelle renforcée, telle que définie par l’article 472 du Code civil, représente un mécanisme juridique spécifique conçu pour répondre à des situations où une personne, bien que nécessitant une protection, conserve une partie de son autonomie. Ce régime se distingue de la curatelle simple par son degré d’intervention dans la gestion des biens et des revenus. En effet, la curatelle renforcée transfère intégralement au curateur la responsabilité de percevoir les revenus de la personne protégée, de gérer les dépenses courantes et de superviser l’utilisation des fonds excédentaires.
Cette mesure, bien que moins radicale que la tutelle, impose une restriction significative à la liberté d’administration des biens, justifiée uniquement par l’incapacité avérée de la personne à assumer cette gestion de manière autonome. Le législateur a encadré cette mesure par des conditions strictes, visant à éviter toute application arbitraire ou disproportionnée.
L’article 472 exige ainsi que le juge constate non seulement l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne (condition commune à toutes les mesures de protection, selon l’article 425 du Code civil), mais également une inaptitude spécifique à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. Cette inaptitude doit être démontrée par des éléments concrets, tels que des actes de dilapidation répétés, une incapacité à budgétiser les dépenses essentielles, ou des comportements financiers irrationnels compromettant la stabilité matérielle de la personne.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 février 2025, insiste sur le caractère indispensable de cette double vérification : la simple existence d’une altération des facultés ne suffit pas à justifier une curatelle renforcée ; il faut établir un lien direct entre cette altération et l’incapacité à gérer les revenus. Cette interprétation stricte de l’article 472 s’inscrit dans une logique de protection des droits fondamentaux. En exigeant une motivation détaillée sur l’inaptitude à gérer les revenus, la Cour de cassation rappelle que les mesures de protection ne doivent pas être utilisées comme des outils de commodité pour régler des conflits familiaux ou simplifier la gestion patrimoniale.
Le juge doit au contraire procéder à une analyse individualisée, prenant en compte les habitudes de vie, les relations familiales et les antécédents financiers de la personne. Par exemple, une personne âgée présentant des troubles cognitifs légers, mais capables de gérer un budget modéré avec l’aide d’un proche ne devrait pas être placée sous curatelle renforcée, sauf si des actes concrets démontrent un risque avéré de précarité.
En l’espèce, la cour d’appel de Besançon a commis une erreur de droit en omettant de justifier en quoi Mme [D] était inapte à percevoir et utiliser ses revenus. En se contentant de mentionner l’article 472 sans décrire les éléments factuels à l’appui, elle a méconnu l’exigence de motivation spécifique imposée par la loi. La Cour de cassation sanctionne cette carence en annulant partiellement l’arrêt, soulignant que la référence légale ne dispense pas les juges du fond d’une démonstration circonstanciée.
B. Le défaut de motivation de la cour d’appel : une violation de la base légale
La motivation des décisions judiciaires est un pilier essentiel de l’État de droit, garantissant la transparence et le contrôle des jugements. Dans le domaine des mesures de protection, cette obligation revêt une importance particulière, car elle touche à des droits fondamentaux tels que la liberté d’administrer ses biens et le respect de la vie privée.
L’article 455 du code de procédure civile impose ainsi aux juges de fonder leurs décisions sur des éléments de fait et de droit clairement exposés, permettant aux parties de comprendre les raisons du choix d’une mesure restrictive. Dans l’affaire concernant Mme [D], la cour d’appel a motivé son arrêt en se bornant à énoncer que la curatelle renforcée était « prévue à l’article 472 du Code civil ». Une telle motivation, jugée insuffisante par la Cour de cassation, constitue une violation de l’obligation légale de motiver les décisions. En effet, l’article 472 ne crée pas un régime autonome ; il s’inscrit dans un ensemble de dispositions (articles 425, 440 et 472 du code civil) qui imposent une démarche cumulative :
- Vérifier l’altération des facultés de la personne ;
- Déterminer si cette altération empêche l’expression de sa volonté ;
- Établir l’inaptitude spécifique à gérer les revenus.
La cour d’appel a omis de remplir la troisième étape, privant ainsi sa décision de base légale. Ce défaut de motivation empêche toute vérification de la proportionnalité de la mesure, ce qui porte atteinte aux droits de la défense. Mme [D] n’a pas pu contester les éléments retenus contre elle ni proposer des alternatives, comme une curatelle simple avec assistance pour certaines dépenses.
La Cour de cassation rappelle ici que les juges du fond doivent expliciter les critères factuels justifiant le choix d’une curatelle renforcée : par exemple, des décisions d’achat irrationnelles, des dettes non honorées malgré des ressources suffisantes, ou une exposition à des risques d’exploitation financière. La cassation partielle prononcée par la Cour illustre le principe de modulation des effets de l’annulation. Seule la modalité de la curatelle renforcée est censurée, car elle est directement liée au vice de motivation.
Les autres dispositions de l’arrêt (durée de la mesure, désignation de l’UDAF comme curateur) sont maintenues, car elles ne dépendent pas de l’erreur commise sur la forme de la curatelle. Cette approche permet d’éviter un renvoi généralisé, tout en préservant la sécurité juridique des aspects non contestés.
II. Les implications de l’arrêt : entre protection des droits fondamentaux et sécurité juridique
A. La garantie des droits individuels face aux mesures restrictives de liberté
La curatelle renforcée, en transférant la gestion des revenus au curateur, constitue une atteinte au principe d’autonomie personnelle, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale). (3)
Pour être légitime, cette atteinte doit répondre à un impératif de nécessité et respecter le principe de proportionnalité, c’est-à-dire être adaptée, nécessaire et strictement mesurée au regard des objectifs poursuivis. La Cour de cassation, en censurant l’arrêt d’appel pour défaut de motivation sur l’inaptitude à gérer les revenus, réaffirme ces exigences. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de concilier protection des vulnérabilités et respect des droits fondamentaux.
Il rappelle que le juge des tutelles doit agir en gardien des libertés individuelles, en privilégiant toujours la mesure la moins restrictive possible. Par exemple, une personne capable de gérer ses dépenses courantes, mais nécessitant une assistance pour les actes patrimoniaux complexes (vente immobilière, investissements) devrait relever d’une curatelle simple, non renforcée.
La Cour de cassation exige ainsi une démonstration active de l’échec des mesures moins contraignantes avant d’envisager une curatelle renforcée. En outre, cet arrêt renforce les garanties procédurales entourant les mesures de protection. Il impose aux juges de solliciter des expertises médicales et sociales approfondies, de recueillir l’avis de la personne protégée (article 431 du code civil) et de motiver leur décision en tenant compte de son projet de vie. Cette approche rejoint les standards internationaux, notamment l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui exige de remplacer les régimes de substitution (tutelle) par des systèmes de soutien à la prise de décision. (4)
B. Les limites pratiques de la cassation : l’effet partiel de la décision et l’absence de renvoi
La Cour de cassation, en annulant uniquement la modalité de la curatelle renforcée, applique le principe de l’autonomie des chefs de dispositif, selon lequel chaque partie d’une décision peut être censurée indépendamment des autres. Dans cette affaire, la fixation de la durée de la mesure à 60 mois et la désignation de l’UDAF comme curateur ne dépendaient pas de la forme retenue pour la curatelle. Ces éléments pouvaient donc être dissociés et maintenus, même après la cassation partielle. Cette solution est renforcée par l’article 627 du Code de procédure civile, qui permet à la Cour de ne pas renvoyer l’affaire lorsqu’un nouvel examen au fond est inutile.
En l’espèce, la Cour estime que la mesure initiale de tutelle ordonnée par le juge des contentieux de la protection a déjà épuisé ses effets, rendant superflu un renvoi. Toutefois, cette analyse soulève des interrogations. La tutelle, plus intrusive que la curatelle, n’avait pas été contestée en appel, mais son maintien après cassation partielle pourrait sembler contradictoire avec l’objectif de proportionnalité.
Enfin, cet arrêt illustre les dilemmes pratiques de la Cour de cassation. D’un côté, elle doit garantir le respect strict des conditions légales et la protection des droits fondamentaux. De l’autre, elle doit préserver la sécurité juridique en limitant les annulations aux seuls vices identifiés. Le choix de ne pas renvoyer l’affaire reflète une volonté d’éviter des procédures interminables, mais pourrait laisser en place des mesures inadaptées si la cour d’appel n’a pas examiné l’ensemble des aspects.
L’arrêt de la Première Chambre civile du 5 février 2025 constitue un jalon important dans l’encadrement juridique des mesures de protection. En exigeant une motivation détaillée sur l’inaptitude à gérer les revenus pour justifier une curatelle renforcée, la Cour de cassation renforce les garanties procédurales et réaffirme le principe de proportionnalité. Cet arrêt rappelle aux praticiens que les mesures de protection doivent reposer sur une analyse concrète et individualisée, évitant les généralités ou les présomptions. Il souligne également les limites du contrôle de la Cour de cassation, tiraillée entre la protection des droits et la sécurité juridique, invitant à une réflexion sur l’évolution des régimes de protection vers des systèmes plus respectueux de l’autonomie.
Sources :
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 février 2025, 23-13.228, Inédit – Légifrance
- Article 472 – Code civil – Légifrance
- La Convention européenne des droits de l’homme (version intégrale) – Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
- Convention relative aux droits des personnes handicapées | OHCHR