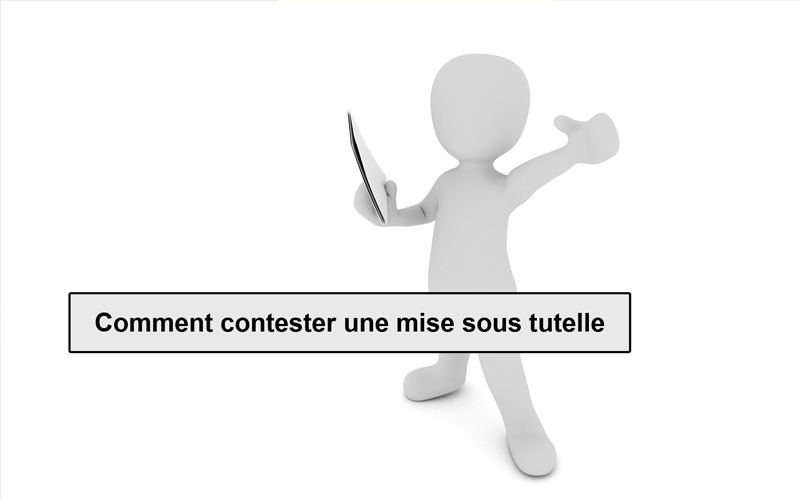Comment contester une mise sous tutelle : cadre juridique et procédure
La mise sous tutelle est une mesure de protection juridique prévue par le Code civil, visant à protéger les personnes majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées au point de ne plus pouvoir exprimer leur volonté ou gérer leurs intérêts. Cependant, une telle décision peut faire l’objet d’une contestation si elle est jugée inappropriée ou injustifiée.
|
Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien |
Contester une mise sous tutelle est un droit pour toute personne concernée ou pour ses proches. Cette contestation doit reposer sur des bases solides, qu’il s’agisse d’une insuffisance de motivation, d’un non-respect des principes légaux ou de nouveaux éléments démontrant l’inutilité de la mesure.
I. Les fondements juridiques de la mise sous tutelle
La mise sous tutelle repose sur plusieurs principes directeurs, notamment ceux de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité.
En vertu de l’article 428 du Code civil (1) :
- La mesure ne peut être décidée que si elle est strictement nécessaire pour protéger la personne.
- Elle doit être subsidiaire, c’est-à-dire qu’un régime moins contraignant comme la curatelle ou la sauvegarde de justice doit être privilégié si cela suffit à protéger la personne.
- Elle doit être proportionnée à l’état de la personne protégée.
Pour être placée sous tutelle, deux conditions cumulatives doivent être remplies :
- Une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté de la personne (C. civ., art. 425 (2).
- La nécessité pour cette personne d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile (C. civ., art. 440 (3).
Le certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste du procureur de la République est obligatoire à peine d’irrecevabilité de la demande de mise sous tutelle (C. civ., art. 431(4) ; C. pr. civ., art. 1218 (5). Ce certificat doit détailler l’altération des facultés, son évolution possible et ses conséquences sur la capacité de la personne à gérer seule ses intérêts (C. pr. civ., art. 1219 (6).
II. Les motifs de contestation d’une mise sous tutelle
Une mise sous tutelle peut être contestée pour plusieurs raisons, notamment :
A. Absence de constat médical conforme
Si le certificat médical n’a pas été établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur conformément à l’article 431 du Code civil ou si ses conclusions ne justifient pas la mise sous tutelle (Civ. 1re, 15 juin 1994, n° 92-19.680 (7) ; Civ. 1re, 29 juin 2011, n° 10-21.879 (8).
Le certificat médical doit impérativement être rédigé par un médecin agréé, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 3211-1 du Code de la santé publique, et tenue à jour par le parquet.
Tout certificat rédigé par un médecin non habilité est juridiquement inopposable.
Une telle irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure de mise sous tutelle.
Le certificat doit être circonstancié, c’est-à-dire décrire :
- La nature des troubles de la personne concernée,
- Leur gravité,
- Leur incidence sur sa capacité à pourvoir seule à ses intérêts,
- Et proposer éventuellement le régime de protection adapté.
Si ces éléments sont absents, la mesure de tutelle peut être contestée pour insuffisance de motivation médicale.
La loi impose une justification claire et précise de la nécessité d’une tutelle (la mesure la plus contraignante), au regard du principe de proportionnalité et du respect de la liberté individuelle.
Il peut également arriver que le certificat médical ne préconise pas expressément une tutelle mais plutôt une mesure moins restrictive (curatelle simple ou renforcée), voire aucune mesure.
Dans ce cas, l’instauration d’une tutelle en dépit de ces conclusions peut être contestée, car contraire à l’esprit des articles 428 et 440 du Code civil, qui imposent de ne prononcer qu’une mesure strictement nécessaire.
B. Non-respect des principes de nécessité et de proportionnalité :
Si une mesure moins contraignante (curatelle ou sauvegarde de justice) aurait suffi pour protéger la personne (Civ. 1re, 7 nov. 2012, n° 11-23.494 (9) ; C. civ., art. 428 (1).
Le Code civil, et en particulier ses articles 428 et 440, encadre strictement le recours aux mesures de protection juridique, telles que la tutelle, en imposant deux principes fondamentaux : la nécessité et la proportionnalité.
Ces principes visent à protéger la personne vulnérable sans porter atteinte de manière excessive à sa liberté ou à son autonomie.
Toute mesure de protection ne peut être prononcée que si elle est indispensable pour permettre à la personne de défendre ses intérêts.
Autrement dit, la mesure ne doit pas être automatique, mais doit reposer sur la démonstration qu’il n’existe aucune autre solution moins contraignante permettant d’assurer la protection nécessaire.
Ainsi, si la personne peut être accompagnée efficacement par un mandat de protection future, une habilitation familiale ou une curatelle, alors la mise sous tutelle ne se justifie pas.
En l’absence d’une justification claire de cette nécessité, la mesure peut être annulée.
Même si une mesure est justifiée par l’état de santé ou de vulnérabilité de la personne, elle doit être adaptée à la situation concrète, ni plus ni moins. La loi impose que le juge choisisse la mesure la plus légère possible au regard des capacités résiduelles de la personne concernée.
La tutelle, en tant que mesure la plus rigide (car elle prive la personne de l’exercice de ses droits civils, qui sont transférés au tuteur), ne doit être prononcée qu’en dernier recours.
Si la personne conserve une part de discernement ou de capacité à accomplir certains actes, une curatelle simple ou renforcée est souvent suffisante.
Une personne protégée peut donc contester une mise sous tutelle en prouvant :
- Que la situation ne justifiait pas une mesure de protection aussi lourde ;
- Que des alternatives moins intrusives n’ont pas été étudiées ou mises en œuvre ;
- Ou que le juge n’a pas pris en compte les capacités réelles de la personne concernée.
Des décisions de justice ont d’ailleurs annulé ou modifié des mesures de tutelle lorsque le juge n’avait pas motivé correctement le choix de cette mesure par rapport à d’autres plus appropriées.
C. Insuffisance de motivation du jugement
Les juges doivent expliquer pourquoi la tutelle est nécessaire, en détaillant les éléments justifiant une représentation continue dans les actes de la vie civile (Civ. 1re, 12 oct. 2022, n° 21-14.887(10).
Tout jugement ordonnant une mesure de protection juridique — et a fortiori une tutelle — doit être motivé en fait et en droit. Cela signifie que les juges doivent expliciter clairement les raisons qui les ont conduits à estimer qu’une tutelle était nécessaire, plutôt qu’une mesure moins contraignante.
Une décision non ou mal motivée ne permet pas aux parties :
- De comprendre les fondements de la décision ;
- D’exercer utilement un recours (appel ou opposition) ;
- Et au juge du second degré de contrôler la régularité et le bien-fondé de la décision.
D. Éléments nouveaux
Si des faits ou des preuves nouvelles démontrent que la tutelle n’est plus nécessaire ou que la situation de la personne a évolué (Civ. 1re, 11 mai 2016, n° 15-21.241 (11).
Une mesure de tutelle peut être remise en question si des éléments nouveaux, intervenus après le jugement, permettent de démontrer que la situation ayant justifié la mesure n’est plus d’actualité. Ces éléments peuvent être de nature médicale, sociale, familiale ou matérielle.
Par exemple, une amélioration significative de l’état de santé de la personne protégée, attestée par un certificat médical actualisé, peut constituer un motif valable pour demander la levée ou l’allègement de la mesure. De même, la mise en place d’un accompagnement social ou familial stable, ou encore le rétablissement des capacités mentales ou physiques de la personne, peut rendre la tutelle excessive et injustifiée.
Dans ce cas, la mesure de tutelle pourrait être remplacée par une mesure moins contraignante (curatelle simple ou renforcée, voire mainlevée complète), conformément au principe de proportionnalité et au respect des droits fondamentaux de la personne.
Ces éléments nouveaux doivent être portés à la connaissance du juge des contentieux de la protection, via une requête accompagnée des pièces justificatives (certificat médical circonstancié, attestations, bilans de suivi, etc.).
III. Les démarches pour contester une mise sous tutelle
A. Le recours devant la juridiction compétente
Le recours contre une décision de mise sous tutelle doit être formé devant la cour d’appel compétente. Ce recours obéit à des règles précises, notamment :
Le délai pour contester une mise sous tutelle est fixé à 15 jours à compter de la notification du jugement (C. pr. civ., art. 1239 (12).
Si la notification intervient à une personne résidant en outre-mer, le délai est augmenté d’un mois (C. pr. civ., art. 644). (13)
Le recours peut être formé par une déclaration au greffe de la juridiction de première instance ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. pr. civ., art. 1242 (14) ; Cass. 1re civ., 11 juill. 2013, n° 12-23.091 (15).
La lettre recommandée n’est pas une formalité substantielle, mais elle est recommandée pour éviter les contestations sur la date de dépôt du recours (Cass. 1re civ., 11 juill. 2013, n° 12-23.091 (15).
Le recours à un avocat n’est pas obligatoire en matière de contestation de tutelle (C. pr. civ., art. 1239 (12).
B. Les arguments à présenter lors du recours
Pour contester une mise sous tutelle, il est essentiel de présenter des arguments solides, tels que :
- L’absence de justification médicale suffisante : Par exemple, si le certificat médical ne décrit pas une altération des facultés empêchant l’expression de la volonté (Civ. 1re, 3 janv. 2006, n° 02-19.537) (16).
- L’évolution de la situation de la personne protégée : Si la personne a recouvré une partie de ses facultés ou si une mesure moins contraignante suffit désormais à la protéger.
- Le non-respect des droits fondamentaux : Toute atteinte disproportionnée aux libertés individuelles ou à la dignité de la personne protégée peut être invoquée (C. civ., art. 415 (17).
IV. Décisions possibles de la cour d’appel
Une fois le recours examiné, la cour d’appel peut :
- Confirmer la mise sous tutelle : Si elle estime que les conditions légales sont remplies et que la mesure est nécessaire.
- Réformer la décision de mise sous tutelle : En la remplaçant par une mesure moins contraignante, comme une curatelle ou une sauvegarde de justice.
- Annuler la décision de mise sous tutelle : Si les conditions légales ne sont pas réunies ou si la procédure est entachée d’irrégularités.
V. Pourvoi en cassation
Si la décision de la cour d’appel est contestée, un pourvoi en cassation peut être formé. Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’arrêt d’appel (C. pr. civ., art. 612 (18). La personne protégée peut également former seule un pourvoi en cassation si la décision attaquée concerne un acte strictement personnel (Civ. 1re, 6 nov. 2013, n° 12-23.766 (19).
SOURCES :
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311088
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427435
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427481
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038310450
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038810487#
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038810482
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032762
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024292566/
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026608949
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046437360
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032531655
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038810391
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747120
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021538160
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027702002
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049978
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427566
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410964
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028175011